Base de données
Approche de conception
Pour concevoir la base de données, j’ai choisi d’utiliser la méthode Merise, approche méthodologique que j’ai étudiée dans ma formation et qui s’avère adaptée aux projets avec des relations entre entités.
Cette méthodologie m’a permis de partir des besoins métier exprimés lors de l’analyse fonctionnelle pour arriver progressivement à une structure de base de données optimisée pour PostgreSQL.
Modèle Conceptuel de Données (MCD)
Le MCD constitue la première étape de ma démarche de modélisation, où je me concentre exclusivement sur les concepts métier de l’haltérophilie sans considération technique. Cette approche m’a permis d’identifier et de structurer les entités fondamentales du domaine ainsi que leurs interactions.
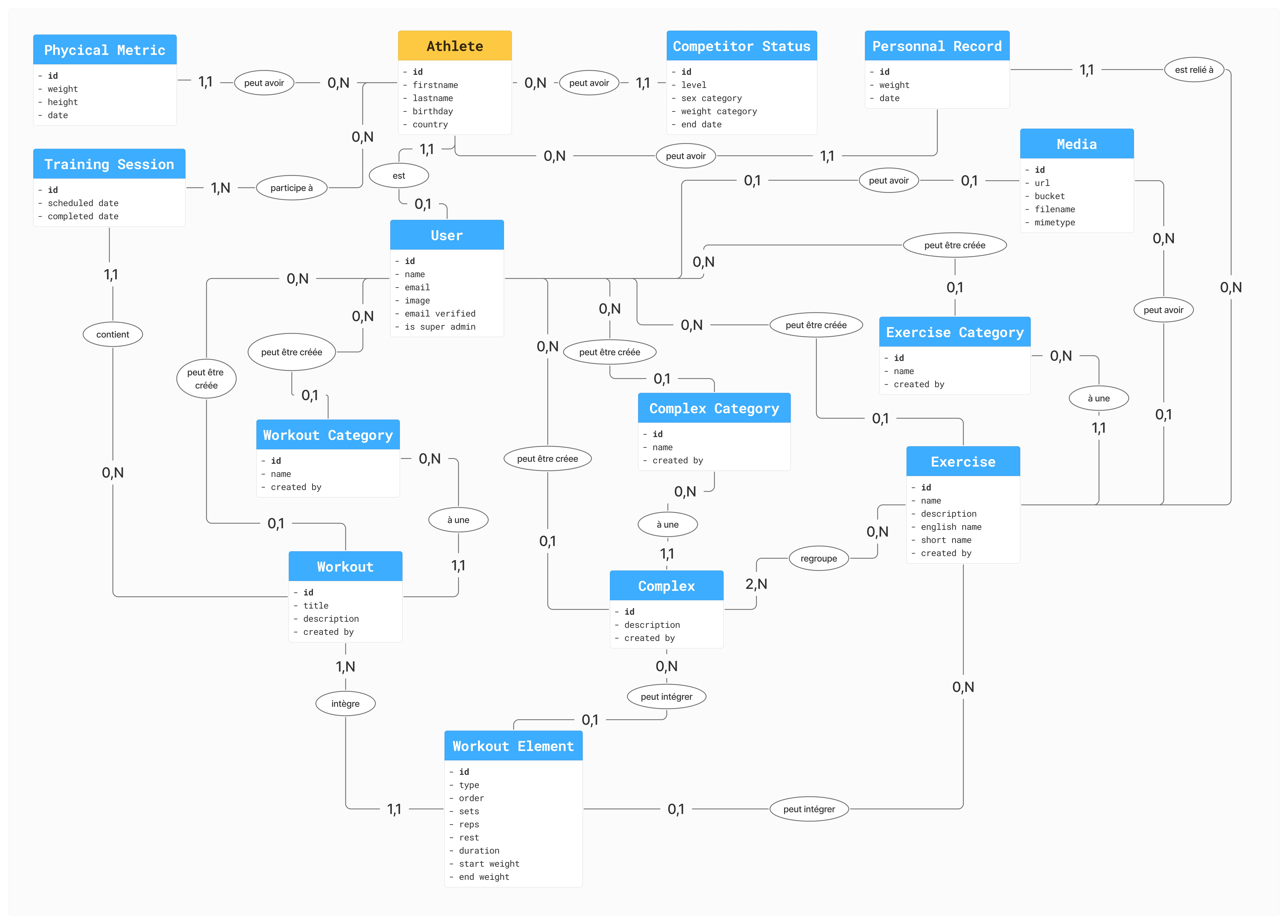
Entités principales identifiées
Athlete : Représente les pratiquants d’haltérophilie. Cette entité centralise les informations personnelles (nom, prenom) et les caractéristiques sportives (niveau, spécialité) nécessaires à la personnalisation des programmes.
Exercise : Catalogue des mouvements d’haltérophilie (épaulé-jeté, arraché, squat, etc.). Chaque exercice comporte des métadonnées spécifiques.
Complex : Catalogue d’ensemble d’exercices ordonnés, utilisé pour travailler un mouvement spécifique en haltérophilie. Un complex enchaîne plusieurs exercices sans repos. Cette composition nécessite au minimum deux exercices pour constituer une séquence cohérente.
Workout : Entraînement créé par un coach. Un workout définit une séquence d’exercices et ou de complex avec leurs paramètres spécifiques: séries, répétitions, charges, temps de repos.
TrainingSession : Séance d’entraînement réalisée par un athlète à partir d’un workout. Cette entité capture la date d’entrainement.
PersonalRecord : Permet d’enregistrer la performance maximal d’un athlète lié à un exercice existant. Ce record permet ensuite de calculer automatiquement les charges que l’athlete doit mettre sur sa barre pour les différents entraînements que le coach établira.
Simplification volontaire du périmètre
Dans ce MCD, j’ai volontairement omis les entités liées à l’authentification et aux autorisations (User, Organization, Role, Permission) qui seront détaillées dans la section Sécurité. Cette approche me permet de me concentrer sur le cœur métier de l’application tout en maintenant la lisibilité du schéma conceptuel.
Modèle Logique de Données (MLD)
Le passage du MCD au MLD constitue l’étape où je traduis les concepts métier en structures relationnelles concrètes. Cette transformation implique la résolution des relations many-to-many et l’introduction des clés étrangères nécessaires à l’intégrité référentielle.
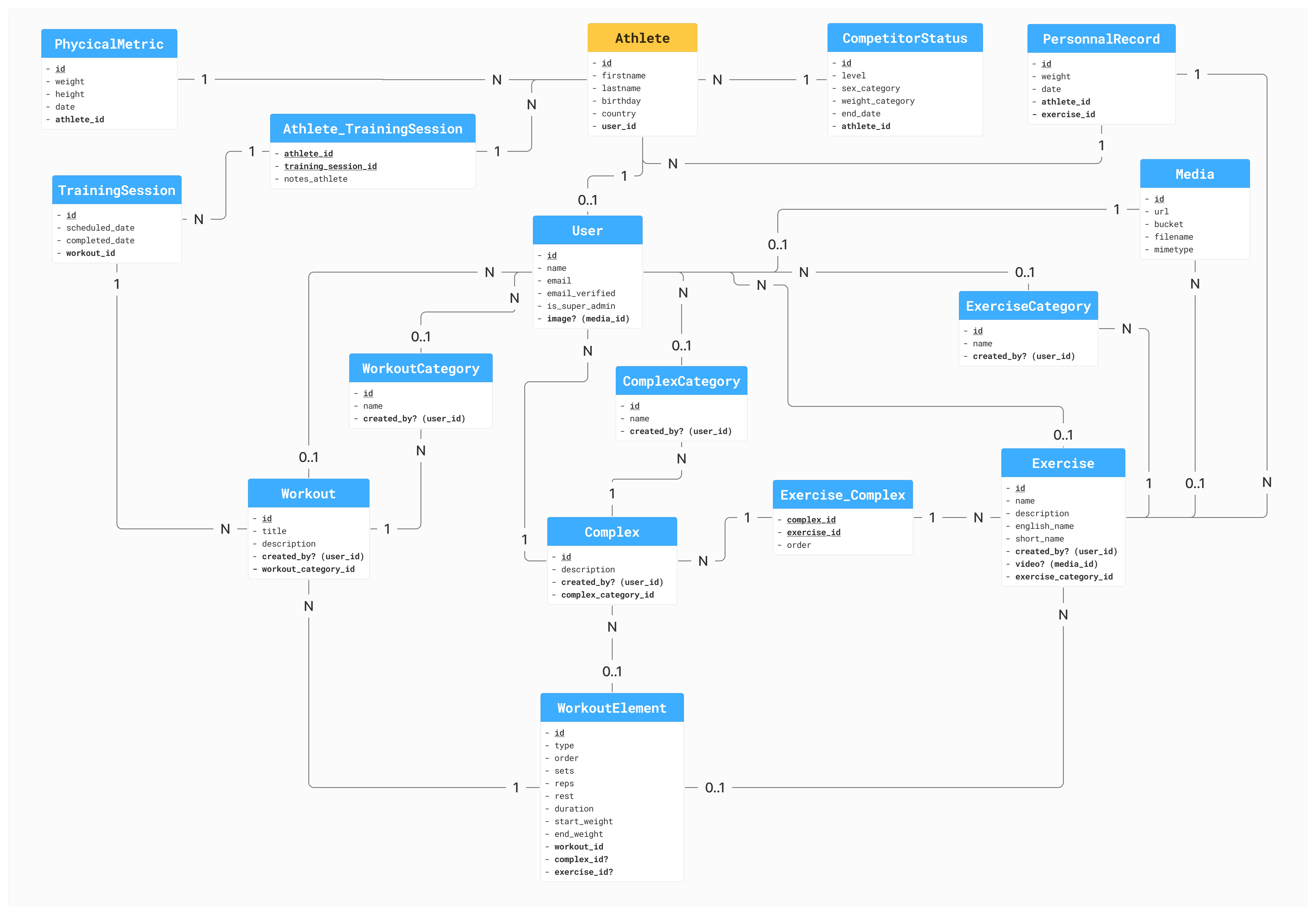
Transformation des relations
Le passage au MLD m’a demandé de résoudre plusieurs types de relations selon les besoins métier :
Relations many-to-many :
AthleteTrainingSession : Lie un athlète à une session d’entraînement avec des informations contextuelles comme le statut de la session et des notes personnelles. Cette table capture la réalisation effective d’un entraînement par un athlète.
Relations one-to-many :
WorkoutElement : Chaque élément d’un workout (exercise ou complex) nécessite des paramètres spécifiques :
type: Indique si l’élément est un exercice simple ou un complexesets,reps: Paramètres de volume d’entraînementstartWeight: Charge prévue en pourcentagerestTime: Temps de récupération entre sériesorder: Position dans la séquence du programme
PersonalRecord : Chaque exercice peut avoir plusieurs records personnels pour un athlète. Ces records servent ensuite au calcul automatique des charges d’entraînement.
Exercise_Complex : Table de jonction qui définit quels exercices composent un complexe et dans quel ordre ils doivent être exécutés.
Relations de référence :
Les entités de catégorisation (ExerciseCategory, WorkoutCategory, ComplexCategory) utilisent des relations one-to-many classiques pour organiser les données.
Modèle Physique de Données (MPD)
Le MPD constitue l’aboutissement de ma démarche de modélisation, traduisant le modèle logique en structure PostgreSQL optimisée. Cette étape implique des choix techniques précis sur les types de données et les contraintes d’intégrité.
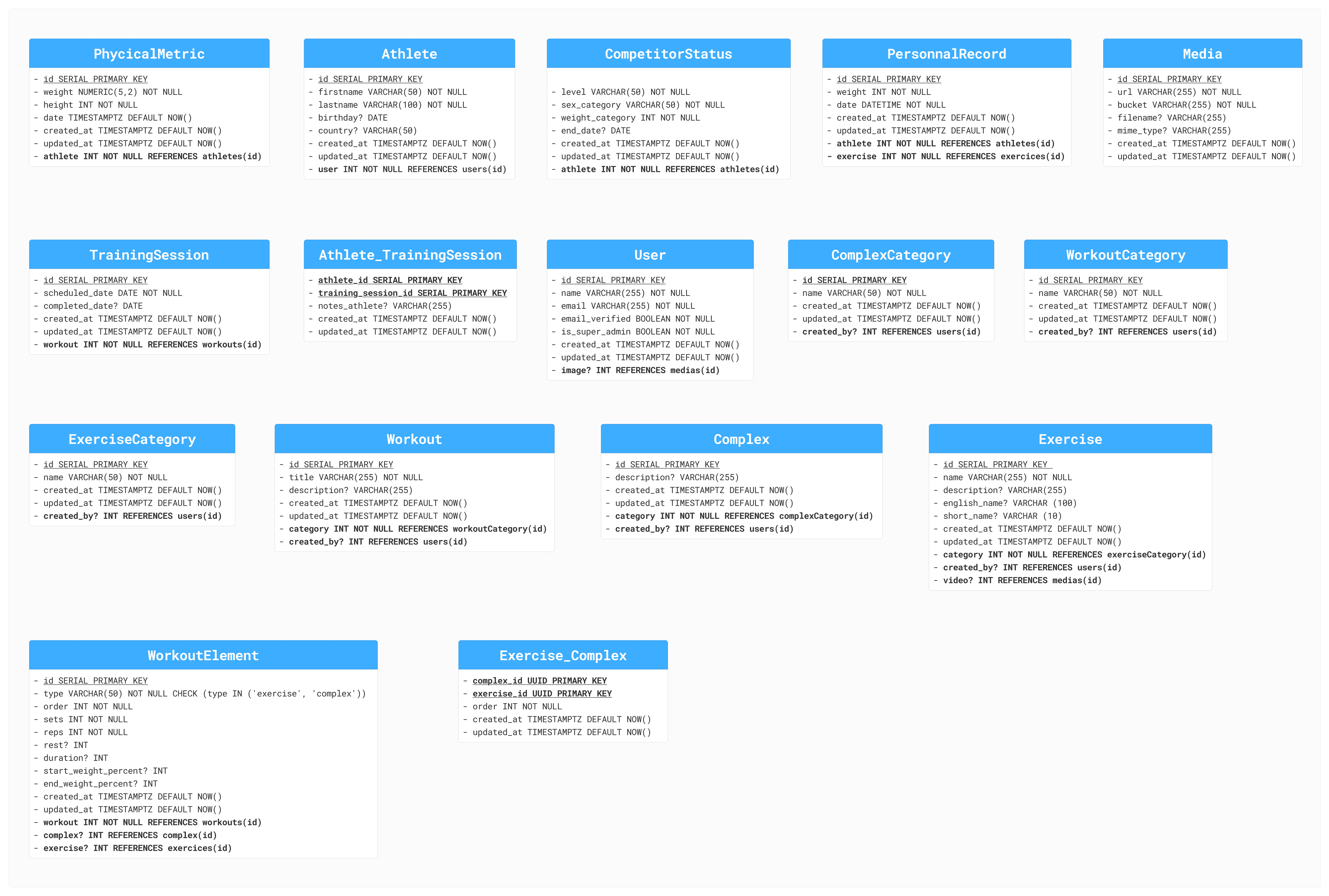
Choix techniques essentiels
Types de données PostgreSQL : J’ai sélectionné des types adaptés aux besoins métier: UUID pour les identifiants, VARCHAR avec contraintes pour les textes, TIMESTAMPTZ pour les dates, INTEGER pour les valeurs numériques, NUMERIC pour les charges et poids (précision exacte).
Gestion des médias : Les ressources visuelles (photos, vidéos d’exercices) sont stockées sur un service externe et référencées par URL dans la base de données, optimisant les performances et simplifiant les sauvegardes.
Pattern de référence polymorphe : Pour permettre aux programmes d’inclure exercices et/ou complexes, j’utilise une table WorkoutElement avec un discriminant element_type et deux clés étrangères optionnelles. Une contrainte CHECK garantit l’intégrité référentielle.
Contraintes d’intégrité
J’ai réparti les contraintes entre validation Zod, use cases et contraintes de base de données selon leur nature :
- Contraintes structurelles : En base de données pour garantir la cohérence (intégrité référentielle)
- Contraintes métier : En Zod pour l’expérience utilisateur (bornes de valeurs, messages d’erreur clairs)
- Contraintes temporelles : Dans les use cases pour le contexte métier
Cette stratification respecte le principe de défense en profondeur.
Stratégie d’évolution
L’architecture actuelle facilite l’ajout de nouvelles fonctionnalités selon les retours d’usage du club. J’ai identifié plusieurs extensions logiques qui pourraient émerger après le lancement du MVP : système de messages du coach, notifications push, catégorisation enrichie des exercices, indicateurs de difficulté, gestion des tempos avancés.
Ces extensions s’intègrent naturellement dans l’architecture existante sans remettre en cause les relations fondamentales. L’évolution du modèle utilisera le système de migrations de MikroORM pour préserver l’intégrité des données existantes.
Pour aller plus loin : Les décisions d’implémentation détaillées (normalisation, choix des UUID, stratégies de contraintes, indexation) sont expliquées dans l’annexe Conception technique de la base de données